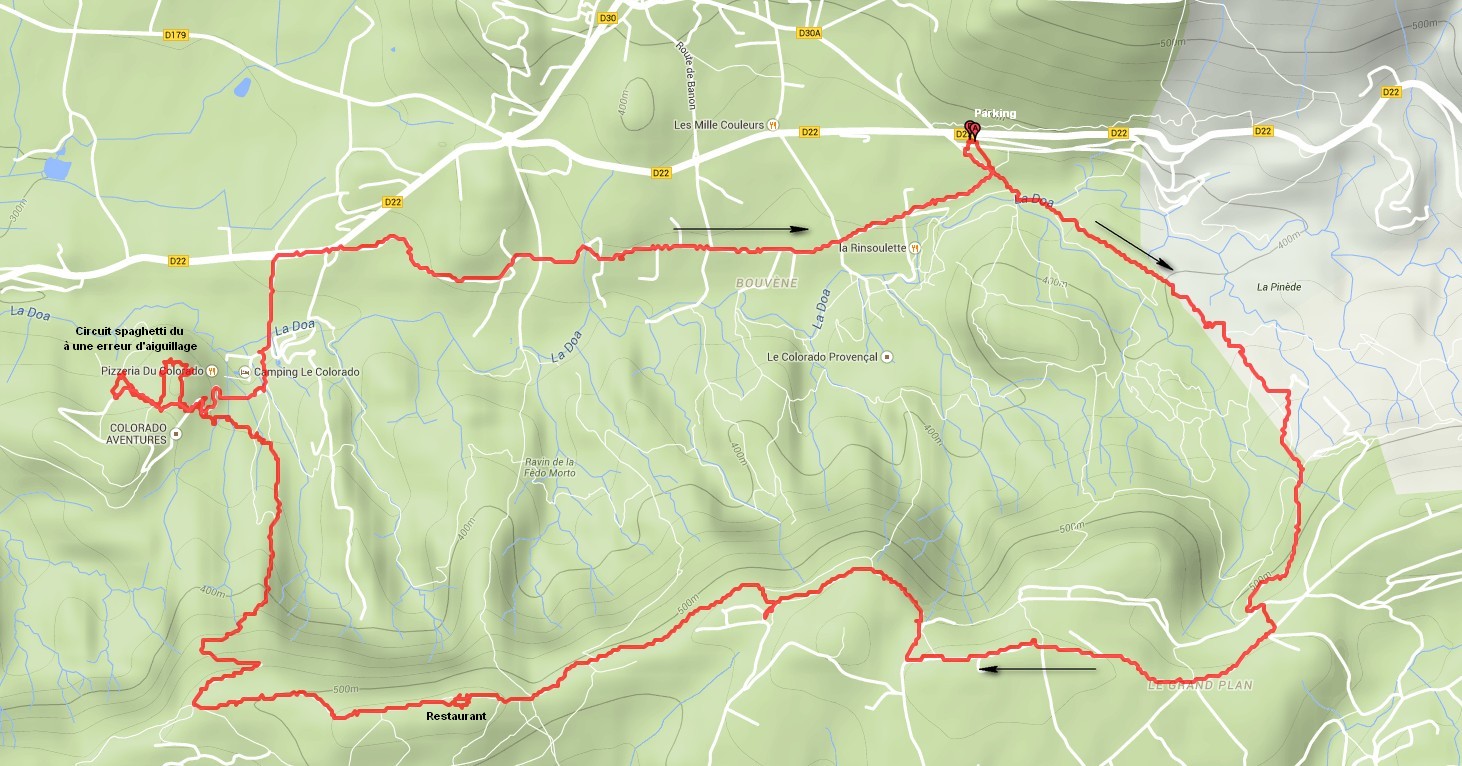|
Née au fond des mers à l'ère secondaire, ((540 à 245 Millions d’années) la roche qui générera l'ocre est un simple grès, constitué par des grains de sable que les vagues et courants accumuleront sur 30
mètres d'épaisseur. Dans les roches de Roussillon, les multiples bancs de sable retracent la vie du fond océanique.
Quelques millions d'années plus tard, la Provence des dinosaures (245 à 65 MA) s'asséchera dans un immense soulèvement géologique. Les sédiments du fond des mers se retrouveront à l'air libre et subiront les
intenses phénomènes d'érosion et d'altération du climat tropical de l'époque.
C'est de cette gigantesque chimiosynth√®se que na√ģtront les sables ocreux issus de l'alt√©ration des petits cristaux de glauconie en oxydes de fer. En circulant dans le sol les eaux de pluies emporteront les
substances colorantes des grès, métamorphosant ceux-ci en roches immaculées et stériles. Elles déposeront ensuite leur charge minérale plus profondément, plus bas dans la terre, créant ainsi la palette des
ocres jaunes et rouges de Roussillon.
Bien avant la colonisation romaine, les premiers habitants avaient déjà compris l'intérêt des gisements d'ocre, pour l'art corporel ou pariétal mais aussi et surtout pour le fer contenu dans ses roches. En effet
ces gisements rec√®lent d'√©normes quantit√©s de minerai ferrugineux qui sera fondu dans les premiers ¬ębas fourneaux¬Ľ de l'antiquit√©. Exploit√© de mani√®re intermittente jusqu'√† la fin du dix-neuvi√®me si√®cle,
le minerai de Rustrel conduira à l'essor économique et industriel de la vallée du Calavon.
Dans les années 1850, aciéries et laminoirs permettront la production d'acier. L'exploitation des forêts pour la production de combustible s'intensifiera au point de désertifier le plateau du Vaucluse et le mont
Ventoux compl√®tement mis √† nu. Mais l'acier vauclusien restera de pi√®tre qualit√© et en l'absence d'un d√©veloppement judicieux des moyens de communication, la r√©gion conna√ģtra sa premi√®re crise sid√©rurgique.
Bien connu depuis la haute antiquité, le pouvoir colorant de l'ocre ne sera véritablement exploité en tant que tel qu'à partir des années 1780, notamment sous l'impulsion de Jean-Etienne Astier qui
découvrira la stabilité et l'inaltérabilité de l'ocre dans les peintures. Il faudra presque un siècle encore, pour que l'extraction et le raffinage de l'ocre atteignent le stade industriel et développent ainsi
l'√©conomie du pays d'Apt, au moment m√™me de l'effondrement de la production d'acier. Avec le dix-neuvi√®me si√®cle, l'ocre conna√ģtra son √Ęge d'or, l'exploitation se rationalisera et de nombreuses mines et
carrières s'ouvriront. Un commerce florissant s'étendra vers les marchés américain puis russe : la richesse économique touchera enfin le pays.
En 1890, 20 000 tonnes d'ocres seront produites et le double en 1930. Mais la crise de 1929, puis la seconde guerre mondiale et l'arrivée des colorants artificiels, signeront la fin de cette époque glorieuse.
Pourtant le commerce de l'ocre ne s'est jamais totalement éteint puisque, aujourd'hui encore, 1000 tonnes d'ocre sont fabriquées chaque année à Apt.
¬ę De sang et d'or ¬Ľ, telle est la maxime qui s'affiche encore √† l'entr√©e du pays de Roussillon. L'ocre a apport√© richesse et prosp√©rit√© durant presque un si√®cle, mais il a √©t√© aussi la source de
querelles, de luttes et de tragédies. Un ocrier aux dix-neuvième et vingtième siècles était, avant tout, un mineur de fond. Dans les galeries ces hommes travaillèrent longtemps à la pioche et à la pelle,
transportant le minerai à la brouette sans autre moyen moderne d'extraction.
Les pollutions dues aux poussières d'ocre empoisonnaient la vie des habitants de Roussillon. Des plaintes contre les exploitants furent déposées dès les années 1800. Les cours d'eau étaient envahis par
les sables de lavage, empêchant
ainsi leur bon écoulement. Le travail et le transport des pigments empoussiéraient l'atmosphère des villages, ce qui apportait beaucoup de nuisances aux ménagères de l'époque !
Au 19ème siècle on l'avait mélangée au chocolat et même utilisé dans les cosmétiques. Au 21ème siècle ce pigment est, plus que jamais, indispensable. Ce produit naturel a d'extraordinaires avantages
sur les colorants de synthèse.
Inerte, inaltérable aux rayons ultra-violets du soleil, il entre dans la composition de dizaines de produits exposés à l'air libre. Sa présence comme pigment dans la composition des matériaux de construction en
est la preuve. Ainsi les peintures, carrelages, enduits et bétons sont teintés à l'ocre. L'industrie chimique incorpore l'ocre dans les engrais et dans le sel de déneigement ; cires, cartons et papiers recyclés
en contiennent également. On recense aussi d'autres utilisations, comme la coloration des porcelaines de Limoges ou le traçage des lignes de marquage des terrains de sports.
|